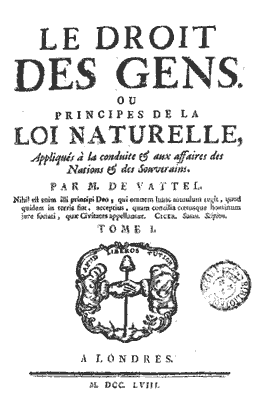
CHAPITRE XVIII
De la manière de terminer les Différends entre les Nations.
§.323 Direction générale sur cette matière.
Les différends qui s'élèvent entre les Nations, ou leurs Conducteurs, ont pour objet, ou des droits en litige, ou des injures. Une Nation doit conserver les droits qui lui appartiennent : Le soin de sa sûreté & de sa gloire ne lui permet pas de souffrir les injures. Mais en remplissant ce qu'elle se doit à elle-même, il ne lui est point permis d'oublier ses devoirs envers les autres. Ces deux vues combinées ensemble, fourniront les Maximes du Droit des Gens sur la manière de terminer les différends entre les Nations.
§.324 Toute Nation est obligée de donner satisfaction sut les justes griefs d'une autre.
Tout ce que nous avons dit dans les Chapitres IV & V de ce Livre, nous dispense de prouver ici, qu'une Nation doit rendre Justice à toute autre sur ses prétentions & la satisfaire sur ses justes sujets de plainte. Elle est donc obligée de rendre à chacune ce qui lui appartient, de la laisser joüir paisiblement de ses Droits, de réparer le dommage qu'elle peut avoir causé, ou l'injure qu'elle aura faite ; de donner une juste satisfaction pour une injure qui ne peut être réparée, & des sûretés raisonnables pour celle qu'elle a donné sujet de craindre de sa part. Ce sont-là tout autant de maximes évidemment dictées par cette justice, dont la Loi Naturelle n'impose pas moins l'observation aux Nations qu'aux particuliers.
§.325 Comment les Nations peuvent abandonner leurs droits & leurs justes griefs.
Il est permis à un chacun de se relâcher de son droit ; d'abandonner un juste sujet de plainte, & d'oublier une injure. Mais le Conducteur d'une Nation n’est point, à cet égard, aussi libre qu'un particulier. Celui-ci peut écouter uniquement la voix de la générosité, & dans une chose qui n'intéresse que lui seul, se livrer au plaisir qu'il trouve à faire du bien, à son goût pour la paix & la tranquillité. Le Réprésentant de la Nation, le Souverain, ne peut se chercher lui-même, s'abandonner à son penchant. Il doit régler toute sa conduite sur le plus grand bien de l'Etat, combiné avec le bien universel de l'humanité, dont il est inséparable : Il faut que, dans toutes les occasions, le Prince considère avec sagesse & exécute avec fermeté ce qui est le plus salutaire à l'Etat, le plus conforme aux Devoirs de la Nation envers les autres ; qu'il consulte en même-tems la Justice, l'équité, l'humanité, la saine Politique, la prudence. Les Droits de la Nation sont des biens, dont le Souverain n’est que l’Administrateur ; il ne doit en disposer que comme il a lieu de présumer que la Nation en disposeroit elle-même. Et pour ce qui est des injures ; il est souvent loüable à un Citoyen de les pardonner généreusement. Il vit sous la protection des Loix ; le Magistrat sçaura le défendre, ou le venger des ingrats & des misérables, que sa douceur enhardiroit à l’offenser de nouveau. Une Nation n'a point la même Sauve-garde : rarement lui est-il salutaire de dissimuler, ou de pardonner une injure, à moins qu'elle ne soit manifestement en état d'écraser le téméraire qui a osé l'offenser. C’est alors qu'il lui est glorieux de pardonner à celui qui reconnoît sa faute :
Parcere subjectis, & debellare superbos
Et elle peut le faire avec sûreté. Mais entre Puissances à-peu-près égales, souffrir une injure sans en exiger une satisfaction complette, est presque toûjours imputé à foiblesse, ou à lâcheté, c'est le moyen d'en recevoir bien-tôt de plus sanglantes. Pourquoi voit-on souvent pratiquer tout le contraire à ceux dont l’âme se croit si fort élevée au-dessus des autres hommes ? A-peine les foibles, qui ont eû le malheur de les offenser, peuvent-ils leur faire des soumissions assez humbles : Ils sont plus modérés, avec ceux qu'ils ne pourroient punir sans danger.
§.326 Des moyens que la Loi Naturelle leur recommande pour finir leurs différends ; 1°, De l'Accommodement amiable.
Si aucune des Nations en différend ne trouve à propos d'abandonner son droit, ou ses prétentions ; la Loi Naturelle, qui leur recommande la paix, la concorde, la charité, les oblige à tenter les voies les plus douces, pour terminer leurs contestations. Ces voies sont,
1°. Un Accommodement amiable. Que chacun examine tranquillement & de bonne-foi le sujet du différend, & qu'il rende Justice ; ou que celui dont le droit est trop incertain, y renonce volontairement. Il est même des occasions où il peut convenir à celui dont le droit est le plus clair, de l'abandonner, pour conserver la paix : C’est à la prudence de les reconnoître. Renoncer de cette manière à son droit, ce n’est pas la même chose que l'abandonner, ou le négliger. On ne vous a aucune obligation de ce que vous abandonnez : Vous vous faites un Ami, en lui cédant amiablement ce qui faisoit le sujet d'une contestation.
§.327 De la Transaction.
La Transaction est un sécond moyen de terminer paisiblement un différend. C'est un accord, dans lequel, sans décider précisément de la justice des prétentions opposées, on se relâche de part & d'autre, & l’on convient de la part que chacun doit avoir à la chose contestée, ou l’on arrête de la donner toute entière à l'une des parties, au moyen de certains dédommagemens, qu'elle accorde à l'autre.
§328 De la Médiation.
La Médiation, dans laquelle un Ami commun interpose ses bons offices, se trouve souvent efficace, pour engager les parties contendantes à se rapprocher, à s'entendre, à convenir, ou à transiger de leurs droits, & s'il s'agit d'injure, à offrir & à accepter une satisfaction raisonnable. Cette fonction exige autant de droiture, que de prudence & de dextérité. Le Médiateur doit garder une exacte impartialité ; il doit adoucir les reproches, calmer les ressentimens, rapprocher les esprits. Son devoir est bien de favoriser le bon droit, de faire rendre à chacun ce qui lui appartient : Mais il ne doit point insister scrupuleusement sur une justice rigoureuse. Il est Conciliateur, & non pas Juge : Sa vocation est de procurer la paix ; & il doit porter celui qui a le droit de son côté, à relâcher quelque chose, s'il est nécessaire, dans la vuë d'un si grand bien.
Le Médiateur n’est pas Garent du Traité qu'il a ménagé, s'il n'en a pris expressément la Garentie. C'est un engagement d'une trop grande conséquence, pour en charger quelqu'un sans son consentement clairement manifesté. Aujourd'hui, que les affaires des Souverains de l'Europe sont si liées, que chacun a l'oeil sur ce qui se passe entre les plus éloignés ; la Médiation est un moyen de conciliation fort usité. S'élève-t-il un différend ? Les Puissances amies, celles qui craignent de voir allumer le feu de la Guerre, offrent leur Médiation, font des ouvertures de paix & d'accomodement.
§.329 De l'Arbitrage.
Quand les Souverains ne peuvent convenir sur leurs prétentions, & qu'ils désirent cependant de maintenir, ou de rétablir la paix ; ils confient quelquefois la décision de leurs différends à des Arbitres, choisis d'un commun accord. Dès que le Compromis est lié, les Parties doivent se soumettre à la Sentence des Arbitres ; elles s'y sont engagées & la foi des Traités doit être gardée.
Cependant, si par une Sentence manifestement injuste & contraire à la raison, les Arbitres s'étoient eux-mêmes dépouillés de leur qualité, leur Jugement ne mériteroit aucune attention ; on ne s'y est soumis que pour des questions douteuses. Supposez que des Arbitres, pour réparation de quelque offense, condamnent un Etat souverain à se rendre sujet de l'offensé ; aucun homme sensé dira-t-il, que cet Etat doit se soumettre ? Si l'injustice est de petite conséquence, il faut la souffrir pour le bien de la paix ; & si elle n’est pas absolument évidente, on doit la supporter, comme un mal, auquel on a bien voulu s'exposer. Car s'il falloit être convaincu de la justice d'une Sentence, pour s'y soumettre ; il seroit fort inutile de prendre des Arbitres.
On ne doit pas craindre, qu'en accordant aux Parties la liberté de ne pas se soumettre à une Sentence manifestement injuste & déraisonnable, nous ne rendions l'Arbitrage inutile ; & cette décision n’est pas contraire à la nature de la soumission, ou du Compromis. Il ne peut y avoir de difficulté que dans le cas d'une soumission vague & illimitée, dans laquelle on n'auroit point déterminé précisément ce qui fait le sujet du différend, ni marqué les limites des prétentions opposées. Il peut arriver alors, comme dans l'exemple allégué tout-à-l'heure, que les Arbitres passent leur pouvoir, & prononcent sur ce qui ne leur a point été véritablement soumis. Appellés à juger de la satisfaction qu'un Etat doit pour une offense, ils le condamneront à devenir sujet de l'offensé. Assûrément cet Etat ne leur a jamais donné un pouvoir si étendu, & leur Sentence absurde ne le lie point. Pour éviter toute difficulté, pour ôter tout prétexte à la mauvaise foi, il faut déterminer exactement dans le Compromis le sujet de la Contestation, les prétentions respectives & opposées, les demandes de l'un & les oppositions de l'autre. Voilà ce qui est soumis aux Arbitres, ce sur quoi on promet de s'en tenir à leur jugement. Alors, si leur Sentence demeure dans ces bornes précises, il faut s'y soumettre. On ne peut point dire qu'elle soit manifestement injuste ; puisqu'elle prononce sur une question, que le dissentiment des Parties rendoit douteuse, qui a été soumise comme telle.
Pour le soustraire à une pareille Sentence, il faudroit prouver par des faits indubitables, qu'elle est l'ouvrage de la corruption, ou d'une partialité ouverte.
L'Arbitrage est un moyen très-raisonnable & très-conforme à la Loi Naturelle, pour terminer tout différend qui n'intéresse pas directement le salut de la Nation. Si le bon droit peut être méconnu des Arbitres, il est plus à craindre encore qu'il ne succombe par le sort des armes. Les Suisses ont eû la précaution, dans toutes leurs Alliances entr'eux, & même dans celles qu'ils ont contractées avec les Puissances voisines, de convenir d'avance de la manière en laquelle les différends devront être soumis à des Arbitres, au cas qu'ils ne puissent s'ajuster à l'amiable. Cette sage précaution n'a pas peu contribué à maintenir la République Helvétique dans cet état florissant, qui assûre sa Liberté, & qui la rend respectable dans l'Europe.
§.330 Des Conférences & Congrès.
Pour mettre en usage quelqu'un de ces moyens, il faut se parler, conférer ensemble. Les Conférences & les Congrès sont donc encore une voie de conciliation, que la Loi Naturelle recommande aux Nations, comme propre à finir paisiblement leurs différends. Les Congrès sont des Assemblées de Plénipotentiaires, destinées à trouver des moyens de conciliation, à discutter & à ajuster les prétentions réciproques. Pour en attendre un heureux succès, Il faut que ces Assemblées soient formées & dirigées par un désir sincère de paix & de concorde. L'Europe a vû dans ce siécle deux Congrès généraux, celui de Cambray (a) en 1724) & celui de Soissons (b) en l728). Ennuyeuses Comédie, jouées sur le Théatre Politique ; & dans lesquelles les principaux Acteurs se proposoient moins de faire un accommodement, que de paroître le désirer.
§.331 Distinction des cas évidens & des cas douteux.
Pour voir maintenant comment & jusqu'à quel point une Nation est obligée de recourrir, ou de se prêter à ces divers moyens, & auquel elle doit s'arrêter ; il faut avant toutes choses, distinguer les cas évidens, des cas douteux. S'agit-il d'un droit clair, certain, incontestable ? Un Souverain peut hautement le poursuivre & le défendre, s'il a les forces nécessaires, sans le mettre en compromis. Ira-t-il composer, transiger, pour une chose qui lui appartient manifestement, qu'on lui dispute sans ombre de droit ? Beaucoup moins la soumettra-t-il à des Arbitres Mais il ne doit point négliger les moyens de conciliation, qui, sans compromettre son droit, peuvent faire entendre raison à son Adversaire : Telles sont la Médiation, les Conférences. La Nature ne nous donne le droit de recourrir à la force, que là où les moyens doux & pacifiques sont inefficaces. Il n’est pas permis d'être si roide dans les questions incertaines & susceptibles de doutes. Qui osera prétendre qu'on lui abandonne tout de suite & sans examen, un droit litigieux ? Ce seroit le moyen de rendre les guerres perpétuelles & inévitables. Les deux Contendans peuvent être également dans la bonne-foi : Pourquoi l'un céderoit-il à l'autre ? On ne peut demander en pareil cas, que l'examen de la question, proposer des Conférences, un Arbitrage, ou offrir une Transaction.
§.332 Des droits essentiels & des droits moins importans.
Dans les Contestations qui s'élèvent entre Souverains, il faut encore bien distinguer les droits essentiels, des droits moins importans. On a à ces deux égards, une conduite bien différente à tenir. Une Nation est obligée à plusieurs devoirs, envers elle-même, envers les autres Nations, envers la Société humaine. On sçait qu'en général les devoirs envers soi-même l'emportent sur les devoirs envers autrui. Mais cela ne doit s'entendre que des devoirs qui ont entr'eux quelque proportion. On ne peut refuser de s'oublier en quelque sorte soi-même, sur des intérêts non-essentiels, de faire quelque sacrifice, pour assister les autres, & sur-tout pour le plus grand bien de la Société humaine. Et remarquons même, que l’on est invité par son propre avantage, par son propre salut, à faire ce généreux sacrifice ; car le bien particulier d'un chacun est intimément lié au bonheur général. Quelle idée auroit-on d'un Prince, d'une Nation, qui refuseroit d'abandonner le plus mince avantage, pour procurer au Monde le bien inestimable de la paix ? Chaque Puissance doit donc cet égard au bonheur de la Société humaine, de se montrer facile à toute voie de conciliation, quand il s'agit d'intérêts non-essentiels, ou de petite conséquence. Si elle s'expose à perdre quelque chose par un accommodement, par une transaction, par un Arbitrage ; elle doit sçavoir quels sont les dangers, les maux, les calamités de la guerre, & considérer que la paix vaut bien un léger sacrifice.
Mais si l’on veut ravir à une Nation un droit essentiel, ou un droit sans lequel elle ne peut espérer de se maintenir ; si un Voisin ambitieux menace la Liberté d'une République, s'il prétend la soumettre & l'asservir ; elle ne prend conseil que de son courage. On ne tente pas même la voie des Conférences sur une prétention si odieuse. On met dans cette querelle tous ses efforts, ses dernières ressources, tout le sang qu'il est beau d'y verser. C'est tout risquer que de prêter l'oreille à la moindre proposition : Alors on peut dire véritablement :.
Una salus… nullam sperare salutem.
Et si la fortune est contraire ; un Peuple libre préfère la mort à la servitude. Que fût devenuë Rome, si elle eût écouté des conseils timides, lorsque HANNIBAL étoit campé devant ses murailles ? Les Suisses, toûjours si prêts à embrasser les voies pacifiques, ou à se soumettre à celles du Droit, dans les contestations moins essentielles, rejettèrent constamment toute idée de composition avec ceux qui en vouloient à leur Liberté ; ils refusèrent même de s'en remettre à l'Arbitrage, ou au Jugement des Empereurs (a) Lorsqu'en l'année 1355, ils soumirent à l'Arbitrage de CHARLES IV leurs différends avec les Ducs d'Autriche, touchant les pays de Zug & de Glaris, ce ne fut que sous cette condition préliminaire, que l'Empereur ne pourroit toucher à la Liberté de ces pays-là, ni à leur Alliance avec les autres Cantons. TSCHUDI p. 429 & suiv., STETTLER p. 77, Histoire de la Confédération Helvétique, par M. DE WATTEVILLE. Liv. V. au commencement.).
§.333 Comment on a le droit de recourrir à la force dans une Cause douteuse.
Dans les Causes douteuses & non essentielles, si l'une des Parties ne veut entendre ni à des Conférences, ni à un Accommodement, ni à Transaction, ni à Compromis ; il reste à l'autre la dernière ressource pour la défense de soi-même & de ses droits, la voie de la force : Et ses Armes sont justes contre un Adversaire si intraitable. Car dans une Cause douteuse, on ne peut demander que tous les moyens raisonnables d'éclaircir la question, de décider le différend, ou de l'accommoder (§.331).
§.334 Et même sans tenter d'autres voies.
Mais ne perdons jamais de vûë ce qu'une Nation doit à sa propre sûreté, la prudence qui doit constamment la diriger. Il n’est pas toûjours nécessaire, pour l'autoriser à courrir aux armes, que tous moyens de conciliation ayent été rejetés expressément ; il suffit qu'elle ait tout lieu de croire que son ennemi ne les embrasseroit pas de bonne-foi, que l’issuë n'en pourrait être heureuse, & que le retardement n'aboutirait qu'à la mettre dans un plus grand danger d'être accablée. Cette maxime est incontestable ; mais l'application en est fort délicate dans la pratique. Un Souverain qui ne voudra pas être considéré comme perturbateur du repos public, ne se portera point à attaquer brusquement celui qui ne s'est point refusé aux voies pacifiques, s'il n’est en état de justifier aux yeux du Monde entier, qu'il a raison de regarder ces apparences de paix, comme un artifice, tendant à l'amuser & à le surprendre. Prétendre s'autoriser de ses seuls soupçons, c'est ébranler tous les fondemens de la sûreté des Nations.
§.335 Du Droit des Gens Volontaire en cette matière.
De tout tems la foi d'une Nation a été suspecte à une autre, & une triste expérience ne prouve que trop, que cette défiance n’est pas mal fondée. L'indépendance & l'impunité sont une pierre de touche, qui découvre le faux or du coeur humain : Le particulier se pare de candeur, de probité ; &, au défaut de la réalité, souvent sa dépendance l'oblige à montrer au moins dans la conduite le fantôme de ces vertus. Le Grand indépendant s'en vante encore plus dans ses discours : Mais dès qu'il se voit le plus fort ; s'il n’a pas un Coeur d'une trempe malheureusement très-rare, à peine cherche-t-il à sauver les apparences : Et si de puissans intérêts s'en mêlent, il se permettra des procédés, qui couvriroient un particulier de honte & d'infamie. Lors donc qu'une Nation prétend qu'il y auroit du danger pour elle à tenter les voies pacifiques, elle n'a que trop de quoi colorer sa précipitation à courrir aux armes. Et comme en vertu de la liberté naturelle des Nations, chacune doit juger en sa conscience de ce qu'elle a à faire, & est en droit de régler, comme elle l'entend, sa conduite sur ses devoirs, dans tout ce qui n’est pas déterminé par les droits parfaits d'une autre (Prélim. §. 20) c'est à chacune de juger si elle est dans le cas de tenter les voies pacifiques, avant que d'en venir aux armes. Or le Droit des Gens Volontaire ordonant que, par ces raisons, on tienne pour légitime ce qu'une Nation juge à propos de faire en vertu de sa Liberté naturelle (Prélim. §.21) ; par ce même Droit Volontaire, on doit tenir pour légitimes entre les Nations, les armes de celle qui, dans une Cause douteuse, entreprend brusquement de forcer son Ennemi à une transaction, sans avoir tenté auparavant les voies pacifiques. Louis XIV étoit au milieu des Pays-bas, avant que l’on sçût en Espagne qu'il prétendait à la Souveraineté d'une partie de ces riches Provinces, du chef de la Reine son Epouse. Le Roi de Prusse, en 1741, publia son Manifeste en Silésie, à la tête de soixante mille hommes. Ces Princes pouvoient avoir de sages & justes raisons d'en user ainsi : Et cela suffit au Tribunal du Droit des Gens Volontaire.
Mais une chose, tolérée par nécessité dans ce Droit peut se trouver très-injuste en elle-même. Un Prince qui la met en pratique, peut se rendre très-coupable en sa Conscience, & très-injuste envers celui qu'il attaque, quoiqu'il n'ait aucun compte à en rendre aux Nations, ne pouvant être accusé de violer les Règles générales, qu'elles sont tenues d'observer entr'elles. Mais s'il abuse de cette Liberté, il se rend odieux & suspect aux Nations, comme nous venons de l'observer : Il les autorise à se liguer contre lui ; & par là, dans le tems qu'il croit avancer ses affaires, il les perd quelquefois sans ressource.
§.336 On doit toûjours offrir des Conditions équitables.
Un Souverain doit apporter dans tous ses différends un désir sincère de rendre justice & de conserver la paix. Il est obligé, avant que de prendre les armes, & encore après les avoir prises, d'offrir des conditions équitables ; & alors seulement, ses armes deviennent justes, contre un Ennemi obstiné, qui se refuse à la justice, ou à l’équité.
§.337 Droit du possesseur, en matière douteuse.
C'est au Demandeur de prouver son droit ; car il doit faire voir qu'il est fondé à demander une chose qu'il ne possède pas. Il lui faut un titre ; & on n’est obligé d'avoir égard à son titre qu'autant qu'il en montre la validité. Le Possesseur peut donc demeurer en possession, jusqu'à-ce qu'on lui fasse voir que sa possession est injuste. Tant que cela n’est pas fait, il est en droit de s'y maintenir, & même de la recouvrer par la force, s'il en a été dépouillé. Par conséquent, il n’est pas permis de prendre les armes, pour se mettre en possession d'une chose, à laquelle on n'a qu'un droit incertain ou douteux. On peut seulement obliger le Possesseur, même, s'il le faut, par les Armes ; à discutter la question, à accepter quelque moyen raisonnable de décision, ou d'accommodement ; ou enfin à transiger sur un pied équitable (§.333).
§.338 Comment on doit poursuivre la réparation d'une injure.
Si le sujet du différend est une injure reçuë ; l'offensé doit suivre les mêmes règles, que nous venons d'établir. Son propre avantage & celui de la Société humaine l'obligent à tenter, avant que d'en venir aux armes, tous les moyens pacifiques d'obtenir ou la réparation de l'injure, ou une juste satisfaction ; à moins que de bonnes raisons ne l'en dispensent (§.334) Cette modération, cette circonspection est d'autant plus convenable, indispensable même, pour l'ordinaire que l’action que nous prenons pour injure, ne procède pas toûjours d'un dessein de nous offenser, & tient quelquefois plus de la faute que de la malice : Souvent même il arrive que l'injure est faite par des subalternes, sans que leur Souverain y ait aucune part : Et dans ces occasions, il est naturel de présumer qu'on ne nous refusera pas une juste satisfaction. Lorsque des subalternes ont violé, il n'y a pas long-tems, le Territoire de Savoye, pour en enlever un fameux Chef de Contrebandiers ; le Roi de Sardaigne a fait porter ses plaintes à la Cour de France ; & Louis XV n'a point cru qu'il fût indigne de sa grandeur, d'envoyer un Ambassadeur extraordinaire à Turin, pour y donner satisfaction de cette violence. Une affaire si délicate s'est terminée d'une maniére également honorable aux deux Rois.
§.339 Du Talion.
Quand une Nation ne peut obtenir Justice, soit d'un tort, soit d'une injure, elle est en droit de se la faire elle-même. Mais avant que d'en venir aux Armes, dont nous traiterons au Livre suivant, il est divers moyens, pratiqués entre les Nations, desquels il nous reste à parler ici. On a mis au nombre de ces moyens de satisfaction, ce qu'on appelle la Loi du Talion, suivant laquelle on fait souffrir à quelqu'un précisément autant de mal qu'il en a fait. Plusieurs ont vanté cette Loi, comme étant de la plus exacte justice ; & faut-il s'étonner s'ils l'ont proposée aux Princes, puisqu'ils ont bien osé la donner pour règle à la Divinité même ? Les Anciens l'appelloient le Droit de RHADAMANTE. Cette idée ne vient que de l'obscure & fausse notion, par laquelle on se réprésente le mal comme une chose digne, essentiellement & en soi de punition. Nous avons montré ci-dessus (Liv. I. §.169) quelle est la véritable source du droit de punir ; d'où nous avons déduit la vraie & juste mesure des peines (Liv. I. §.171). Disons donc qu'une Nation peut punir celle qui lui a fait injure, comme nous l'avons montré ci-dessus (voyez les Chapitres IV. & VI. de ce Livre), si celle-ci refuse de donner une juste satisfaction ; mais elle n’est pas en droit d'étendre la peine au-delà de ce qu'exige sa propre sûreté. Le Talion, injuste entre les particuliers, seroit d'une pratique beaucoup plus injuste entre les Nations ; parcequ'ici la peine tomberoit difficilement sur ceux qui auroient fait le mal. De quel droit ferez-vous couper le nez & les oreilles à l'Ambassadeur d'un barbare, qui aura traité le vôtre de cette manière ? Pour ce qui est de ces réprésailles, en tems de Guerre, qui tiennent du Talion ; elles sont justifiées par d'autres principes, & nous en parlerons en leur lieu. Tout ce qu'il y a de vrai dans cette idée du Talion, c’est que, toutes choses d'ailleurs égales, la peine doit garder quelque proportion avec le mal qu'il s'agit de punir ; la fin même & le fondement des peines l'exigeant ainsi.
§.340 Diverses manières de punir, puis en venir aux armes.
Il n'est pas toûjours nécessaire d'en venir aux armes, pour punir une Nation ; l'offensé peut lui ôter en forme de peine des droits, dont elle joüissoit chez lui, se saisir, s'il en a le moyen, de quelques-unes des choses qui lui appartiennent, & les retenir, jusqu'à-ce qu'elle donne une juste satisfaction.
§.341 De la rétorsion de Droit.
Quand un Souverain n’est pas satisfait de la manière dont ses sujets sont traités par les Loix & les usages d'une autre ; Il est le maître de déclarer, qu'il usera envers les sujets de cette Nation-là, du même Droit dont elle use envers les siens. C'est ce qu'on appelle Rétorsion de Droit. Il n'y a rien là que de juste & de conforme à la saine Politique. Nul ne peut se plaindre de ce qu'il est traité comme il traite les autres. C'est ainsi que le Roi de Pologne Electeur de Saxe fait valoir le Droit d'Aubaine seulement contre les sujets des Princes qui y assujettissent les Saxons. Cette Rétorsion de Droit peut avoir lieu encore à l'égard de certains Règlemens, dont on n’est point en droit de se plaindre, que l’on est même obligé d'approuver, mais contre l'effet desquels il convient de se garder, en les imitant. Tels sont les ordres qui concernent l'entrée, ou la sortie de certaines Denrées ou Marchandises. Souvent aussi il ne convient pas d'user de rétorsion. Chacun peut faire à cet égard ce que lui dicte sa prudence.
§.342 Des réprésailles.
Les Réprésailles sont usitées de Nation à Nation, pour se faire justice soi-même, quand on ne peut pas l'obtenir autrement. Si une Nation s'a emparée de ce qui appartient à une autre, si elle refuse de payer une dette, de réparer une injure, ou d'en donner une juste satisfaction ; celle-ci peut se saisir de quelque chose appartenante à la prémière, & l'appliquer à son profit, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû avec dommages & intérêts, ou la tenir en gage, jusques-à-ce qu'on lui ait donné une pleine satisfaction. Dans ce dernier cas, c’est plûtôt Arrêt ou Saisie, que Réprésailles : On les confond souvent dans le langage ordinaire. Les effets saisis se conservent, tant qu'il y a espérance d'obtenir satisfaction, ou justice. Dès que cette espérance est perdue, on les confisque ; & alors les Réprésailles s'accomplissent. Si les deux Nations, sur cette querelle, en viennent à une rupture ouverte ; la satisfaction est censée refusée, dès le moment de la Déclaration de Guerre, ou des prémières hostilités, & dès-lors aussi les effets saisis peuvent être confisqués.
§.343 De ce qui est requis pour qu'elles soient légitimes.
Le Droit des Gens ne permet les Réprésailles que pour une Cause évidemment juste, pour une dette claire & liquide. Car celui qui forme une prétention douteuse ne peut demander d'abord que l'examen équitable de son droit. En second lieu, il faut avant que d'en venir là, que l’on ait inutilement demandé Justice, ou au moins que l’on ait tout lieu de croire qu'on la demanderoit vainement. Alors seulement on peut se faire soi-même raison d'un injuste. Il seroit trop contraire à la paix, au repos & au salut des Nations, à leur Commerce mutuel, à tous les devoirs qui les lient ses unes envers les autres, que chacune pût tout d'un coup en venir aux voies de fait, sans savoir si l’on est disposé à lui rendre justice, ou à la refuser.
Mais pour bien entendre cet article, il faut observer, que si dans une affaire litigieuse, notre Adversaire se refuse aux moyens de mettre le droit en évidence, ou les élude artificieusement, s'il ne se prête pas de bonne-foi aux moyens pacifiques de terminer le différend, & sur-tout, s'il en vient le prémier à quelque voie de fait ; il rend notre Cause juste, de problématique qu'elle étoit ; nous pouvons mettre en usage les Réprésailles, ou la saisie de ses effets, pour le contraindre à embrasser les moyens de conciliation que la Loi Naturelle prescrit. C'est une dernière tentative, avant que d'en venir à une Guerre ouverte.
§.344 Sur quels biens elles s'exercent.
Nous avons observé ci-dessus (§.81) que les biens des Citoyens font partie de la totalité des biens d'une Nation ; que d'Etat à Etat, tout ce qui appartient en propre aux membres est considéré comme appartenant au Corps, & est affecté pour les dettes de ce Corps (§.82) : D'où il suit, que dans les Réprésailles, on saisit les biens des sujets, tout comme on saisiroit ceux de l'Etat, ou du Souverain. Tout ce qui appartient à la Nation est sujet aux Réprésailles, dès qu'on peut s'en saisir ; pourvû que ce ne soit pas un Dépôt confié à la Foi publique. Ce Dépôt ne se trouvant entre nos mains que par une suite de la confiance, que le propriétaire a mise en notre bonne-foi ; il doit être respecté, même en cas de Guerre ouverte. C'est ainsi que l’on en use en France, en Angleterre & ailleurs, à l'égard de l'argent que les étrangers ont placé dans les Fonds-publics.
§.345 L’on doit dédommager ceux qui souffrent par des réprésailles.
Celui qui use de réprésailles contre une Nation, sur les biens de ses membres indistinctement, ne peut être taxé de saisir le bien d'un innocent pour la dette d'autrui. Car c'est alors au Souverain à dédommager celui de ses sujets, sur qui sont tombées les réprésailles ; c'est une dette de L'Etat, ou de la Nation, dont chaque Citoyen ne doit supporter que sa quote-part.
§.346 Le Souverain seul peut ordonner les Représailles.
C’est seulement d'Etat à Etat, que tous les biens des particuliers sont regardés comme appartenans à la Nation. Les Souverains agissent entr'eux ; ils ont affaire les uns aux autres directement, & ne peuvent considérer une Nation étrangère que comme une société d'hommes dont tous les intérêts sont communs. Il n'appartient donc qu'aux Souverains d'exercer & d'ordonner les Réprésailles, sur le pied que nous venons de les expliquer. D'ailleurs cette voie de fait approche fort d'une rupture ouverte, & souvent elle en est suivie. Elle est donc d'une trop grande Conséquence, pour être abandonnée aux particuliers. Aussi voyons-nous qu'en tout Etat policé, un sujet qui se croit lézé par une Nation étrangère, recourt à son Souverain, pour obtenir la permission d'user de réprésailles. C'est ce qu'on appelle en France, demander des Lettres de Marque.
§.347 Comment elles peuvent avoir lieu contre une Nation, pour le fait de ses sujets, & en faveur des sujets lézés.
On peut user de réprésailles contre une Nation, non-seulement sur les faits du Souverain, mais aussi sur ceux de ses Sujets : Et cela a lieu quand l'Etat, ou le Souverain participe à l'action de son sujet & s'en charge ; ce qu'il peut faire en diverses manières, suivant que nous l'avons expliqué au Chapitre VI de ce Livre.
De même, le Souverain demande justice, ou use de réprésailles, non-seulement pour ses propres affaires, mais encore pour celles de ses Sujets, qu'il doit protéger, & dont la Cause est celle de la Nation.
§.348 Mais non en faveur des Etrangers.
Mais accorder des réprésailles contre une Nation, en faveur d'Etrangers, c'est se porter pour Juge entre cette Nation & ces Etrangers ; ce qu'aucun Souverain n’est en droit de faire. La Cause des réprésailles doit être juste, & il faut même qu'elles soient fondées sur un déni de justice, ou Déjà arrivé, ou probablement à craindre (§.343). Or quel droit avons-nous de juger si la plainte d'un Etranger contre un Etat indépendant est juste, si on lui a fait un vrai déni de justice ? Si l’on m'oppose, que nous pouvons bien épouser la querelle d'un autre Etat, dans une Guerre qui nous paroît juste, lui donner du sécours, & même nous joindre à lui ; le cas est différent. En donnant du sécours contre une Nation, nous n'arrêtons point ses effets, ou ses gens, qui se trouvent chez nous sous la foi publique ; & en lui déclarant la Guerre, nous lui permettons de retirer & ses sujets & ses effets, comme on le verra ci-dessous. Dans le cas des réprésailles accordées à nos Sujets, une Nation ne peut se plaindre que nous violions la foi publique, en saisissant ses hommes ou ses biens ; parceque nous ne devons la sûreté à ces biens, ou à ces hommes, que dans la juste supposition, que cette Nation ne violera pas la prémière, envers nous ou nos sujets, les règles de justice que les Nations doivent observer entr'elles : Si elle les viole, nous sommes en droit d'en tirer raison, & la voie des réprésailles est plus aisée, plus sûre & plus douce, que celle de la Guerre. On ne pourroit justifier par les mêmes raisons, des Réprésailles ordonnées en faveur d'étrangers. Car la sûreté que nous devons aux sujets d'une Puissance, ne dépend point, comme d'une condition, de la sûreté que cette Puissance donnera à tous les autres peuples, à des gens qui ne nous appartiennent point ; qui ne sont pas sous notre protection. L'Angleterre ayant accordé des réprésailles, en 1662 contre les Provinces-unies, en faveur des Chevaliers de Malte, les Etats de Hollande disoient avec raison, que selon le Droit des Gens, les réprésailles ne peuvent être accordées que pour maintenir les Droits des sujets de l'Etat, & non pour une affaire à laquelle la Nation n'a aucun intérêt (a) Voyez BYNCKERSHOCK : du Juge compétent des Ambassadeurs ; Chap. XXII. §. V.).
§.349 Ceux qui ont donné lieu aux Réprésailles, doivent dédommager ceux qui en souffrent.
Les particuliers qui, par leurs faits, ont donné lieu à de justes réprésailles, sont obligés de dédommager ceux sur qui elles tombent, & le Souverain doit les y contraindre. Car on est tenu à la réparation du dommage, que l’on a causé par sa faute. Et bien que le Souverain, en refusant justice à l'offensé, ait attiré les réprésailles sur ses sujets ; ceux qui en sont la prémière cause, n'en deviennent pas moins coupables ; la faute du Souverain ne les exempte pas de réparer les suites de la leur. Cependant, s'ils étoient prêts à donner satisfaction à celui qu'ils ont lézé ou offensé, & que leur Souverain les en ait empêchés ; ils ne sont tenus qu'à ce qu'ils auroient été obligés de faire pour prévenir les réprésailles, & c'est au Souverain à réparer le surplus du dommage, qui est une suite de sa propre faute (§.345).
§.350 De ce qui peut passer pour un refus de faire Justice.
Nous avons dit (§.343) qu'on ne doit venir aux réprésailles, que quand on ne peut point obtenir justice. Or la Justice se refuse de plusieurs manières :
1°, Par un déni de justice proprement dit, ou par un refus d'écouter vos plaintes, ou celles de vos sujets, de les admettre à établir leur droit devant les Tribunaux ordinaires.
2°, Par des délais affectés, dont on ne peut donner de bonnes raisons ; délais équivalens à un refus, ou plus ruineux encore.
3°, Par un jugement manifestement injuste & partial. Mais il faut que l'injustice soit bien évidente & palpable. Dans tous les cas susceptibles de doute, un Souverain ne doit point écouter les plaintes de ses Sujets contre un Tribunal étranger, ni entreprendre de les soustraire à l'effet d'une Sentence renduë dans les formes. Ce seroit le moyen d'exciter des troubles continuels. Le Droit des Gens prescrit aux Nations ces égards réciproques pour la jurisdiction de chacune, par la même raison que la Loi Civile ordonne dans l'Etat, de tenir pour juste toute Sentence définitive, renduë dans les formes. L'obligation n’est ni si expresse, ni si étenduë de Nation à Nation ; mais on ne peut nier qu'il ne soit très-convenable à leur repos, & très-conforme à leurs devoirs envers la Société humaine, d'obliger leurs Sujets, dans tous les cas douteux & à moins d'une lésion manifeste, à se soumettre aux Sentences des Tribunaux étrangers, par devant lesquels ils ont affaire (Voyez ci-dessus §.84).
§.351 Sujets arrêtés par réprésailles.
De même que l’on peut saisir les choses qui appartiennent à une Nation, pour l'obliger à rendre Justice, on peut également, & pour les mêmes raisons, arrêter quelques-uns de ses Citoyens, & ne les relâcher que quand on a reçû une entière satisfaction. C’est ce que les Grecs appelloient Androlepsie, prise d'homme. A Athènes, la Loi permettoit aux parens de celui qui avoit été assassiné dans un pays étranger, de saisir jusqu'à trois personnes de ce pays-là, & de les détenir, jusqu'à-ce que le meurtrier eût été puni ou livré (a) DEMOSTH. Orat. adv. Aristocrat.). Mais dans les mœurs de l'Europe moderne, ce >moyen n’est guères mis en usage que pour se faire raison d'une injure de même nature, c’est-à-dire pour obliger un Souverain à relâcher quelqu'un, qu'il détient injustement.
Au reste, les sujets ainsi arrêtés n'étant détenus que comme une sûreté, un gage, pour obliger une Nation à faire justice ; si leur Souverain s'obstine à la refuser, on ne peut point leur ôter la vie, ni leur infliger aucune peine corporelle, pour un refus, dont ils ne sont pas coupables. Leurs biens, leur liberté même peut être engagée pour les dettes de l'Etat, mais non point la vie, dont l'homme n’est pas le maître de disposer. Un Souverain n’est en droit d'ôter la vie aux sujets de celui qui lui fait injure, que quand ils sont en guerre ; & nous verrons ailleurs ce qui lui donne ce droit.
§.352 Droit contre ceux qui s'opposent aux Réprésailles.
Mais un Souverain est en droit d'user de force contre ceux qui résistent à l'exécution de son droit ; & d'en user autant qu'il est nécessaire pour surmonter leur injuste résistance. Il est donc permis de repousser ceux qui entreprennent de s'opposer à de justes réprésailles, & s'il faut pour cela aller jusqu'à leur ôter la vie, on ne peut accuser de ce malheur que leur résistance injuste & inconsidérée. GROTIUS veut qu'en pareil cas, on s'abstienne plûtôt d'user de réprésailles (a) Droit de la G. & de la P. Liv. III. Chap. II. §. VI). Entre particuliers, & pour des choses qui ne sont pas extrêmement importantes, il est certainement digne, non-seulement d'un Chrétien, mais en général de tout honnête homme, d'abandonner plûtôt son droit, que de tuer celui qui lui oppose une injuste résistance. Mais il n'en va pas ainsi entre les Souverains. Il seroit d'une trop grande conséquence de se laisser braver. Le vrai & juste bien de l’Etat est la grande règle La modération est toûjours loüable en elle-même ; mais les Conducteurs des Nations doivent en user autant qu'elle peut s'allier avec le bonheur & le salut de leurs peuples.
§.353 De justes réprésailles ne donnent point un juste sujet de guerre.
Après avoir démontré, qu'il est permis d'en venir aux réprésailles, quand on ne peut obtenir justice autrement ; il est aisé d'en conclure, qu'un Souverain n'est point en droit d'opposer la force, ou de faire la Guerre à celui, qui ordonnant & exécutant des réprésailles en pareil cas, ne fait qu'user de son droit.
§.354 Comment on doit se borner aux réprésailles, ou en venir enfin à la Guerre.
Et comme la Loi de l'humanité ne prescrit pas moins aux Nations, qu'aux particuliers, de préférer constamment les moyens les plus doux, quand ils suffisent pour obtenir justice ; toutes les fois qu'un Souverain peut, par la voie des réprésailles, se procurer un juste dédommagement, ou une satisfaction convenable, il doit s'en tenir à ce moyen, moins violent & moins funeste que la Guerre. A ce propos, je ne puis me dispenser de relever ici une erreur trop générale pour être absolument méprisée. S'il arrive qu'un Prince ayant à se plaindre de quelque injustice, ou de quelques commencemens d'hostilités, & ne trouvant pas chez son Adversaire des dispositions à lui donner satisfaction, se détermine à user de réprésailles, pour essayer de le contraindre à écouter la Justice, avant que d'en venir à une rupture ouverte : S'il saisit ses effets, ses Vaisseaux, sans Déclaration de Guerre, & les retient comme des gages : Vous entendrez certaines gens crier au brigandage. Si ce Prince eût déclaré la Guerre tout de suite, ils ne diroient mot, ils loüeroient peut-être sa conduite. Etrange oubli de la raison & des vrais Principes ! Ne diroit-on pas que les Nations doivent suivre les Loix de la Chevalerie, se défier en Champ clos, & vuider leur querelle comme deux Braves dans un Duel ? Les Souverains doivent penser à maintenir les Droits de leur Etat, à se faire rendre Justice, en usant de moyens légitimes, & en préférant toûjours les plus doux : Et encore un coup, il est bien évident que les Réprésailles dont nous parlons, sont un moyen infiniment plus doux, ou moins funeste que la Guerre. Mais comme elles y conduisent souvent, entre Puissances dont les forces sont à-peu-prés égales ; on ne doit y venir qu'à l'extrémité. Le Prince qui tente alors cette voie, au lieu de rompre entièrement, est loüable sans-doute, pour sa modération & sa prudence.
Ceux qui courent aux armes sans nécessité, sont des fléaux du Genre-humain, des barbares, ennemis de la société & rebelles aux Loix de la Nature ou plûtôt du Père commun des hommes.
Il est des cas cependant, où les Réprésailles seroient condamnables, lors même qu'une Déclaration de Guerre ne le seroit pas ; & ce sont précisément ceux dans lesquels les Nations peuvent avec justice prendre les armes. Lorsqu'il s'agit dans le différend, non d'une voie de fait, d'un tort reçu, mais d'un droit contesté ; après que l'on a inutilement tenté les voies de conciliation ou les moyens pacifiques d'obtenir justice, c'est la Déclaration de Guerre qui doit suivre, & non de prétenduës Réprésailles, lesquelles, en pareil cas, ne seroient que de vrais actes d'hostilité, sans Déclaration de Guerre, & se trouveroient contraires à la foi publique, aussi bien qu'aux devoirs mutuels des Nations. C'est ce qui paroîtra plus évidemment, quand nous aurons exposé les raisons qui établissent l'obligation de déclarer la Guerre, avant que d'en commencer les actes (a) Voyez Liv. III. Chap. IV.).
Que si, par des conjonctures particulières, & par l'obstination d'un injuste Adversaire, ni les réprésailles, ni aucun des moyens dont nous venons de traiter, ne suffisent pour notre défense & pour la protection de nos droits, il reste la malheureuse & triste ressource de la Guerre, qui fera le sujet du Livre suivant.
FIN du Livre II du Droit Des Gens.
Table des matières <
Précédent
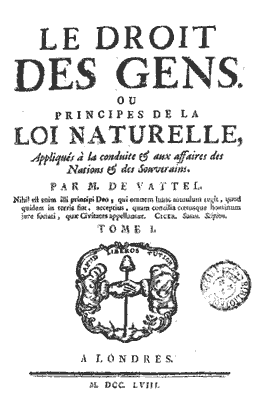 CHAPITRE VIII
CHAPITRE VIII












