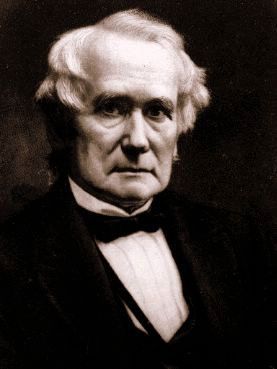Henry Charles Carey - Principes de la science sociale - Tome I - Chapitre XIII, notes de bas de page
PRINCIPES DE LA SCIENCE SOCIALE
PAR M. H.-C. CAREY (De Philadelphie)
TRADUITS EN FRANÇAIS PAR MM. SAINT-GERMAIN-LEDUC ET AUG. PLANCHE
1861
CHAPITRE XIII :
CONTINUATION DU MÊME SUJET.
Notes de bas de page
1 GREIG. Histoire de l'Inde britannique, t. I, p. 46. Retour
2 Fragments historiques, Londres, 1805, p. 409. Retour
3 « Le pays fut transformé en solitude par le fer et le feu, et cette terre qui s'élevait au-dessus de la plupart des autres, par le spectacle si doux à considérer d'un gouvernement fraternel et de la protection acccordée au travail, cette terre, le séjour d'élite de l'agriculture et de l'abondance, est aujourd'hui, pour ainsi dire, un désert effrayant couvert de joncs et de ronces et de jungles remplis de bêtes féroces... — Cette violation générale et systématique des traités, qui a rendu proverbiale dans l'Orient la foi britannique ! ces révoltes calculées, forment une des ressources perpétuelles de la Compagnie des Indes. Lorsque l'on croit que l'argent a été accumulé quelque part, ceux qui le possèdent sont généralement accusés de rébellion, jusqu'au moment où ils sont déchargés, à la fois, de leur argent et de l'accusation ! Une fois l'argent enlevé, toute accusation, procès ou châtiment sont mis à néant. » (Discours au sujet du bill de Fox sur l'Inde.) Retour
4 « Partout où la puissance britannique supplanta la puissance mahométane au Bengale, nous n'adoptâmes point, il est vrai, la partie sanguinaire de leur croyance ; mais puisant à la source impure de leur système financier, nous réclamâmes, à notre honte, l'héritage du droit de s'emparer de la moitié du produit brut de la terre à titre d'impôt ; et partout où nos armes ont triomphé, nous avons constamment proclamé ce droit sauvage en l'associant, dans le même moment, avec cette doctrine absurde, que le droit du propriétaire est également inhérent au souverain, en vertu du droit de conquête. » (RICKARDS. L'Inde, t. Ier, p. 275.) Retour
5 « L'iniquité du gouvernement anglais fut portée à un point qui semble à peine compatible avec l'existence de la société. On força les indigènes d'acheter cher et de vendre bon marché. On outragea impunément les magistrats, la police et les autorités fiscales du pays. C'est ainsi que des fortunes énormes furent amassées à Calcutta, où 30,000 êtres humains furent réduits à l'extrême misère. On les avait accoutumés à vivre sous la tyrannie, mais jamais sous une tyrannie semblable. Ils trouvèrent le petit doigt de la Compagnie plus pesant que les reins de Sujarah Dowlah. Sous leurs anciens maîtres, ils leur restaient au moins une ressource ; lors que le mal devenait insupportable, le peuple s'insurgeait et renversait le gouvernement. Mais le gouvernement anglais n'était pas de ceux que l'on peut ébranler ainsi. Ce gouvernement oppresseur, comme représentant la forme la plus écrasante du despotisme barbare, était fort de toute la puissance de la civilisation. Il ressemblait au gouvernement de génies malfaisants, plutôt qu'à celui de tyrans humains. » (MACAULAY.) Retour
6 On appelle ainsi, dans l'Inde, les petits cultivateurs qui occupent le terrain par bail à perpétuité. Retour
7 Citation extraite des « Lectures de Thompson sur l'lnde », p. 61. Retour
8 RICKARDS. L'Inde, t. Ier, p. 500. Retour
9 « Une prime de 50 % sur l'imposition est allouée, à titre de récompense, à tout individu qui dénonce une culture clandestine, etc., et l'on a constaté qu'il y a presque dans chaque village, des comptables congédiés cherchant à être employés de nouveau, et des serviteurs sans emploi, qui cherchent à se faire remarquer et sur les services desquels on peut compter comme dénonciateurs. » (CAMPBELL, L'Inde moderne, Londres, 1852, p. 356.) Retour
10 BAINES. Histoire de la fabrication des étoffes de coton. Retour
11 CAMPBELL. L'Inde moderne, p. 382. Retour
12 Ibid., p. 381. Retour
13 Ibid., p. 105. Retour
14 La différence qui existe entre le propriétaire terrien (landlord) dépensant dans un pays éloigné tous ses revenus, et le propriétaire qui, résidant sur son domaine, les répartit parmi ses tenanciers en échange de services, et la différence, dans la valeur des produits de la terre, résultant de la proximité du marché, sont si bien démontrés dans le passage suivant, extrait d'un ouvrage moderne sur l'Inde, que le lecteur en le lisant ne peut manquer d'en faire son profit :
« La majeure partie du froment, du blé et autres produits de la terre susceptibles d'exportation que le peuple consomme, aussi loin que nous avons pénétré jusqu'à présent, est tirée de nos districts de Nerbudda et de ceux de Malwa qui y confinent ; et, par conséquent, le prix a été croissant rapidement, à mesure que nous quittons ces districts pour nous avancer dans la direction du nord. Si le sol de ces districts de Nerbudda, situés, ainsi qu'ils le sont, loin de tout marché important pour leurs produits agricoles, était d'aussi mauvaise qualité qu'on le trouve dans certaines parties du Bundelcund que j'ai parcourues, on ne pourrait en tirer un excédant de revenu net dans l'état actuel des arts et de l'industrie. Les prix élevés que l'on paye ici pour les produits de la terre étant dus à la nécessité de tirer, de pays si éloignés, une grande partie de ce qui se consomme, permet aux rajahs de ces états du Bundelcund de recueillir des impôts aussi considérables que ceux qu'ils perçoivent. Ces chefs dépensent la totalité de leurs impôts à entretenir des établissements publics d'un genre quelconque ; et comme les articles essentiels de subsistance, le froment et le blé, etc., qui sont produits sur le territoire de leurs propres districts, ou ceux qui les avoisinent immédiatement, ne suffisent pas pour approvisionner ces établissements, ils doivent les tirer de territoires éloignés. Tous ces produits sont portés à dos de boeufs, parce qu'il n'existe point de route, partant des districts d'où ils font venir cet approvisionnement, sur laquelle on puisse faire circuler sûrement une voiture à roues ; et comme ce mode de transport est très-coûteux, le prix des produits, lorsqu'ils arrivent dans les capitales, aux alentours desquels ces établissements locaux sont concentrés, devient très-élevé. Il faut qu'ils payent un prix égal aux débours réunis nécessaires pour acheter et transporter ces substances alimentaires, des districts les plus éloignés, auxquels ils sont obligés d'avoir recours, à tout moment, pour l'approvisionnement, ou bien qu'ils cessent d'être approvisionnés ; et comme il ne peut exister deux prix pour la même denrée sur le même marché, le froment et le blé produits dans le voisinage de l'une de ces villes principales du Bundelcund y obtiennent un prix aussi élevé, que le blé et les céréales arrivant des districts les plus éloignés situés sur les bords de la rivière de Nerbudda, tandis qu'ils ne coûtent rien, comparativement, à transporter des premiers pays aux marchés. Ces terres, en conséquence, aiment une rente bien plus considérable, si on la compare avec leur puissance productrice et fécondante naturelle, que celle des districts éloignés dont le produit est tiré de ces marchés ou de ces chefs-lieux ; et comme toutes les terres sont la propriété des rajahs, ils perçoivent toutes ces rentes comme un revenu public. Si nous recevions ce revenu dont jouissent aujourd'hui les rajahs, à titre de tribut, pour l'entretien d'établissements publics concentrés dans des siéges éloignés, tous ces établissements locaux seraient immédiatement désorganisés ; et toute la demande effective qu'ils satisfont, des produits bruts agricoles venant de districts agricoles éloignés, cesserait. Le prix des produits diminuerait en proportion, et avec lui la valeur foncière des districts situés aux alentours de ces chefs-lieux. De là, la folie des conquérants et des souverains, depuis le temps des Grecs et des Romains, jusqu'à celui de lord Hastings et de sir John Malcolm, qui tous étaient de mauvais économistes, lorsqu'ils supposaient que les territoires conquis et cédés pouvaient toujours devenir susceptibles de rapporter, à un État étranger, le même revenu brut qu'ils avaient payé à leur gouvernement national, quelle que fût leur situation par rapport aux marchés destinés à écouler leurs produits, quels que fussent l'état des arts et de l'industrie, la nature et l'étendue des établissements locaux situés au dehors. Les baux établis par rapport à l'impôt foncier, sur tous les territoires acquis dans l'Inde centrale pendant la guerre avec les Marattes, qui expirèrent en 1817, l'avaient été, d'après la supposition : que les terres continueraient à payer, sous le nouveau gouvernement, le même taux de rente que sous l'ancien, sans qu'aucune influence fût exercée par la réduction du nombre de tous les établissements locaux, civils et militaires, au dixième de ce qu'ils avaient été ; qu'avec le nouvel ordre de choses toutes les terres en friche devaient être soumises à la culture, et pourraient rembourser un taux de rente aussi élevé qu'avant a cette opération ; et que, conséquemment, l'ensemble du revenu net dont on pouvait profiter devait augmenter considérablement et rapidement. Ceux qui avaient à régir l'établissement de ces baux et le gouvernement de ces nouveaux territoires ne réfléchissaient pas que l'amoindrissement de chaque établissement était l'anéantissement d'un marché — d'une demande effective des produits de la terre ; et que, lorsque toutes les terres en friche seraient mises en culture, la totalité dégénérerait sous le rapport de la fertilité, par suite du défaut de mise en jachères, sous l'empire du système régnant d'agriculture, qui ne fournissait pas aux terres d'autres moyens de rénovation, par suite d'une récolte surabondante. Les baux pour l'impôt foncier qui avaient été conclus dans l'étendue de nos nous velles acquisitions, d'après ces suppositions erronées, ne furent point, conséquemment, exécutés. Pendant une succession de baux quinquennaux, l'établissement de l'impôt avait été partout réduit, graduellement, environ aux deux tien de ce qu'il était lorsque notre domination commença ; et à une somme moindre de moitié de ce que sir John Malcolm, et le digne marquis de Hastings lui-même, avaient pensé qu'il rendrait, d'après leurs propres opinions. Les revenus fonciers des princes indigènes de l'Inde centrale, qui réduisirent le nombre de leurs établissements publics, que le nouvel ordre de choses semblait rendre inutiles, et diminuèrent ainsi leurs uniques marchés pour les produits bruts de leur terre, ces revenus, disons-nous, ont manqué partout dans la même proportion ; et à peine aujourd'hui un de ces princes recueille les deux tiers du revenu qu'il tirait des mêmes terres en 1817.
« Il existe dans la vallée de Nerbudda des districts qui donnent, chaque année, un produit bien plus considérable que Orcha, Jansée ou Duteaa ; et cependant, en l'absence de ces mêmes marchés nationaux, ils ne rapportent pas le quart du montant du revenu foncier. Les terres sont toutefois évaluées à un taux aussi élevé ; quant à l'assiette de l'imposition, en proportion de leur valeur pour les fermiers et les cultivateurs. Pour devenir susceptibles de rendre un impôt plus considérable, elles ont besoin d'avoir des établissements plus vastes, comme marchés pour les produits de la terre. Ces établissements doivent être, ou publics et rétribués par le gouvernement, ou bien ils peuvent être privés, comme des manufactures, par l'intermédiaire desquelles le produit de la terre de ces districts sera consommé par des individus occupés de placer la valeur de leur travail dans des denrées appropriées à la demande faite par des marchés éloignés, et plus précieuses que le produit de la terre, relativement à leur poids et à leur volume. Ce sont là des établissements que le gouvernement doit s'efforcer d'introduire et de protéger, puisque la vallée de Nerbudda, outre un sol d'une excessive fécondité, possède, sur tout son parcours, depuis sa source jusqu'à son embouchure, de riches gisements houillers, placés pour les besoins des générations futures, sous la couche de grès des chaines du Sathpore et du Vindhya et des gisements non moins riches d'excellent fer. Ces avantages n'ont pas encore été moins appréciés comme ils devaient l'être ; mais ils le seront bientôt. » (SLEEMAN. Excursions dans l'Inde, t. Ier, p. 296.) Retour
15 L'humble pétition suivante des malheureux indigènes montre dans tout son jour le caractère du système :
Calcutta, 1er septembre 1831.
Aux Très-Honorables Lords du conseil privé de Sa Majesté pour le trafic, etc. L'humble pétition des soussignés, manufacturiers et négociants en étoffes de coton et de soie des fabriques du Bengale,
Expose : — Que dans ces dernières années, les pétitionnaires ont vu leur industrie presque complètement anéantie par l'introduction, au Bengale, de produits fabriqués en Angleterre, dont l'importation augmente chaque année au grand préjudice des manufacturiers indigènes.
— Que les produits fabriqués en Angleterre sont consommés au Bengale, sans être frappés d'aucun droit qui protége les produits fabriqués par les indigènes.
— Que les produits fabriqués au Bengale sont grevés des droits suivants, lorsqu'on en fait usage en Angleterre :
Sur les tissus de coton fabriqués 10%
Sur les tissus de soie fabriqués 24%
Les pétitionnaires prient très-humblement Vos Seigneuries de prendre en considération un pareil état de choses, et ils osent croire qu'il n'existe en Angleterre aucune disposition législative, qui interdise l'entrée à l'industrie d'aucune portion des habitants de ce vaste empire.
Ils demandent donc d'être admis à jouir du privilège des sujets anglais, et supplient humblement Vos Seigneuries d'admettre en Angleterre l'usage des tissus de coton et de soie fabriqués au Bengale, en franchise de droit, ou en n'imposant qu'un droit égal à celui dont peuvent être grevés les produits des fabriques anglaises consommés au Bengale.
Vos Seigneuries ne doivent pas ignorer les immenses avantages que les manufacturiers retirent de leur habileté à construire et à employer des machines, qui leur permet de vendre à plus bas prix que les manufacturiers peu savants du Bengale et dans leur propre pays ; et bien que les pétitionnaires n'aient pas la confiance de recueillir quelque avantage important, si leur supplique est accueillie avec faveur, leur esprit sera satisfait par cette manifestation du bon vouloir de Vos Seigneuries à leur égard ; et un tel exemple de justice envers les indigènes de l'Inde ne peut manquer de leur faire aimer le gouvernement anglais.
Ils ont donc la ferme confiance que la juste considération de Vos Seigneuries s'étendra sur eux comme étant sujets britanniques, sans exception de secte, de pays ou de couleur.
Et les pétitionnaires, ainsi que cela est leur devoir, prieront toujours pour vous.
(Signé par 117 indigènes occupant la position la plus honorable.) Retour
16 CHAMAN. Le coton et le commerce de l'Inde, Londres, 1851. Retour
17 « En prenant dans une période de treize années, les six dernières, le prix du coton a été de 2 pence la livre, et si le produit d'un beegah était de 6 schell. 6 pence, sur cette somme le gouvernement prélevait 68 % du produit brut ; et en prenant les deux années 1841 et 1842, le prix du coton était de 1 penny 3/4 la livre et le produit d'un beegah était de 5 schell. 8 pence. D'après ces données, l'impôt établi était réellement équivalent à 78 % sur le produit brut de la terre. » (Discours de M. Bright à la chambre des communes.) Retour
18 CHAPMAN. Du Coton et du Commerce et de l'Inde. p. 110. Retour
19 L'Économiste de Londres. Retour
20 « En 1846 ou 1847, le collecteur fut obligé d'accorder remise de la taxe foncière, parce que l'abondance des années antérieures avait amené la stagnation dans la province, et que les bas prix du blé résultant de cette cause empêchaient les ryots de pouvoir payer leur imposition foncière fixe. » (CHAPMAN. Du Coton et du Commerce de l'Inde, p. 97.) Retour
21 Excursions dans l'Inde, t. I, p. 205. Retour
22 Ibid., p. 268. Retour
23 CHAPMAN. Du Coton et du Commerce de l'Inde, p. 97. Retour
24 Ibid., p. 22. Retour
25 Ibid., p. 25. Retour
26 « Si un ryot creusait un puits, sa rente à payer était augmentée, s'il creusait un petit canal, elle était presque doublée. Il n'y avait donc aucune possibilité d'amélioration. De plus, la terre étant partagée entre des paysans dont le travail était le seul capital, deux mauvaises saisons les réduisaient presque à la famine. » Dans de pareilles circonstances, tout le revenu était occasionnellement perdu en remises. Conséquemment, personne ne devenait jamais riche et dans toute l'étendue de la présidence, il n'y a pas probablement dix fermiers dont l'avoir puisse s'évaluer à 1 000 liv. sterl. La superficie de la terre cultivée ne forme que le cinquième de la superficie de la présidence, et il ne paraît pas qu'elle tende à s'accroître. » (London Times.) Retour
27 Jusqu'à ce jour les produits des impôts établis sur la population de l'Inde ont été, dans une proportion considérable, dépensés sur les lieux et ont contribué à créer une demande du travail et de ses produits. Aujourd'hui ils doivent être transférés à Calcutta et ajouteront vraisemblablement, dit-on, deux millions de livres sterl. au revenu de la Compagnie des Indes. L'impôt, lorsque les produits en sont dépensés sur les lieux, n'est qu'une question de distribution. Dans le cas contraire, c'est une question d'épuisement. Dix millions, dans le premier cas, ne causeraient pas autant de désastre qu'un million dans le second. Retour
28 « La Cour des directeurs nous informe « qu'il y a eu diminution dans le total » des recettes provenant de l'impôt foncier dans les anciennes provinces du Bengale, depuis l'année 1843-44 ; et assurément nul ne peut être surpris d'apprendre un pareil fait. Dans la présidence de Madras, la population est réduite à un état de pauvreté déplorable, la terre a peu de valeur, et la culture n'y est maintenue que par des moyens forcés, les habitants se refusant à cultiver la terre à aucunes conditions. A Bombay, les recettes ont manqué, et le pays, à ce qu'on nous rapporte, n'est pas généralement dans un état prospère. Nous apprenons par un membre du conseil de cette présidence que l'Inde touche aux dernières limites du paupérisme et que les habitants effectuent leurs paiements au gouvernement central, en engageant ou vendant leurs objets de toilette personnelle, et même leurs bestiaux, leur mobilier et leurs outils ; c'est-à-dire que le capital du pays est entamé pour payer les impôts. C'est le même fonctionnaire qui, il y a cinq ans, affirmait, devant une commission nommée par le Parlement, que la condition des cultivateurs dans l'Inde était considérablement abaissée, et, à ce qu'il craignait, en décadence. L'aristocratie des indigènes s'éclipse partout, la race des gentlemen du pays a presque partout disparu, et les paysans deviennent insouciants au milieu de leur ruine. Après chaque période d'un petit nombre d'années, la famine sévit ; et le gouvernement dépense, en efforts désespérés pour faire vivre la population, l’argent avec lequel on eût pu faire des routes, conduisant aux greniers, aux ports, et pour recueillir l'excédant des produits des provinces plus fortunées. Dans ces lieux qu'auraient traversé des subsistances en échange d'autres denrées, le chemin était jonché des cadavres amaigris de centaines de milliers d'individus d'une population affamée jusqu'à en mourir. » (London, Daily-Notes.) Retour
29 Voy. CAMPBELL. L'Inde moderne, chap. XI. Retour
30 Excursions dans l’Inde, t. II, p. 109. Retour
31 L'Inde moderne, par CAMPBELL, p. 394. Retour
32 CAMPBELL, p. 377. Retour
33 CAMPBELL. L'Inde moderne, p. 359. Que la torture variée sous diverses formes soit un des modes établis pour percevoir l'impôt, c'est là un fait admis par la Compagnie, et l'un de ceux sur lesquels récemment l'attention du parlement a été appelée. Comme cependant c'est un moyen dont l'existence surgit de la nécessité des circonstances, on ne peut lui appliquer aucun remède. La misère de la population s'accroit chaque jour, et avec elle s'accroit la difficulté de lever l'impôt, et quelles que puissent être les dispositions des gouverneurs, ceux-ci dans de pareilles circonstances doivent exiger une proportion, constamment croissante, des produits constamment décroissants de la terre et du travail. Retour
34 Ibid., p. 332. Retour
35 CHAPMAN. Du Coton et du Commerce de l'Inde. Retour
36 MAC CULLOCH. Dictionnaire du Commerce, article Calcutta. Retour
37 « Nous sommes en guerre avec les Birmans. Chacun le sait, et ce qui est pire, chacun s'attend à ce que nous le serons toujours avec une puissance quelconque dans l'Orient. Il en était de même à Rome. Chacun admettait comme une chose naturelle, qu'une guerre, ou deux, eussent lieu aux confins de l'Empire ; avec les Carthaginois ou les Maures, les Celtibériens ou les peuples de l'Helvétie, les Syriens ou les Égyptiens ; et lorsqu'enfin il se trouva, pendant une année miraculeuse, que la terreur inspirée par Rome, ou l'épuisement de toute la race humaine, arrivèrent à ce point, que la guerre ne sévit plus réellement, le temple de Janus fut fermé dans la capitale, on célébra des jeux, on chanta des hymnes et l'empereur fut proclamé Dieu, de son vivant. Il en a été de même à l'égard de tous les grands empires. »
« II n'y a aucune différence dans ce que nous aurions à énoncer sur le fait important de cette guerre déshonorante, et en ce moment si désastreuse. La cause de la guerre contre les Birmans, ce ne sont pas les réclamations de deux capitaines anglais, car on leur avait promis de régler cette affaire ; ce n'est pas la conduite du gouverneur qui a donné lieu à ces réclamations, car il été promptement congédié ; ce ne sont pas, davantage, les absurdes et fabuleux griefs de la lie des gens de Rangoun rassemblés par le Commodore après son arrivée ; car ces griefs ne furent jamais formellement articulés, ni aucun acte ou refus sérieux de satisfaction, mais simplement et uniquement ceci : que quatre fonctionnaires de rangs très-divers et très-inégaux, qui avaient pénétré par force dans la cour du commissaire royal, sans aucune disposition préalable, et à une heure du jour tout à fait inusitée, étaient restés un quart d'heure exposés au soleil. Des explications et des excuses sans fin furent offertes, mais aucune ne fut admise. » (Le Times de Londres). Retour